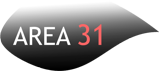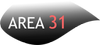Kamel Daoud
Gallimard, nrf
23€ 412 pages
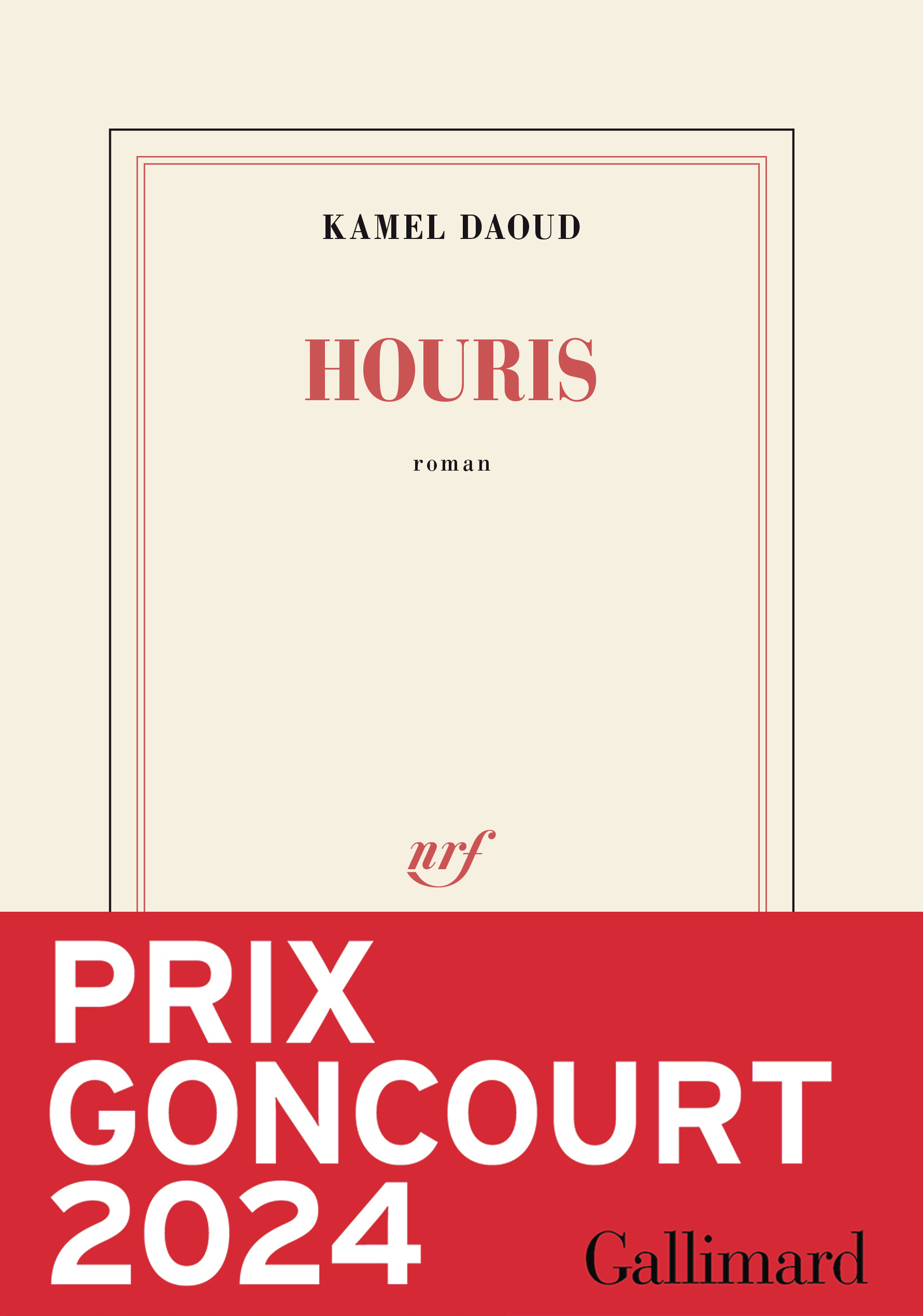
Un Goncourt pas comme les autres puisqu’il met en histoire une période sombre et – si nous pouvons risquer cet oxymore – éclairante du contentieux entre les esprits libres que nous nous attachons à être, comme Kamel Daoud, et l’obscurantisme criminel, composante de l’islamisme, devenu religion d’Etat en Algérie.
L’ouvrage commence par citer l’article 46 de la « charte pour la paix et la réconciliation nationale ». Il promet des peines de prison à toute personne qui, d’une manière ou d’une autre, romprait l’omerta concernant les massacres perpétrés sur la population algérienne, par villages entiers, femmes, enfants et vieillards compris, au nom du Dieu des imams, dans la décennie 1990-2000, soit 200000 personnes.
La paix sociale ne mérite pas, semble-t-il, ce nom quand elle s’obtient par la menace, lorsqu’elle couvre de son silence la domination du Pouvoir sur la population et celle des mâles sur la gent féminine.
Daoud s’était fait connaître par un premier roman « Meursault, contre-enquête ». Le frère de l’algérien gratuitement abattu par le personnage de Camus répétait le même geste le jour de l’Indépendance et tuait, de façon similaire, un certain Joseph qui ne lui avait rien fait. Daoud est natif d’Oran, comme Aube, l’héroïne, et, accessoirement, comme l’auteur de cette fiche. Il a longtemps été journaliste au Quotidien d’Oran. La ville est très reconnaissable, en dépit du changement des noms de rue consécutif à l’indépendance de l’Algérie. « Houris » montre la force supérieure d’évocation d’un roman, en comparaison avec un essai politique.
L’écriture est vive, inventive et élégante. C’est une prouesse d’auteur de se mettre ainsi dans la peau d’une jeune femme enceinte, dans l’incapacité de parler, après avoir été égorgée et laissée pour morte à 5 ans, parmi les cadavres de sa famille. Le sourire, autre nom pour la cicatrice de l’égorgement, fait 17 centimètres. Aube s’en sert, ainsi que de ses yeux verts, pour défier silencieusement un iman imprécateur voisin. Le lieu de prière, aménagé dans un local commercial, n’est séparé de son salon de coiffure que par une ruelle.
La progression du récit ne nous laisse pas en repos. Le dialogue intérieur d’Aude nous est livré à rebours. Elle parle à son fœtus qu’elle imagine fille – il n’y a pas eu, en effet, d’échographie pour établir le sexe de l’enfant à naître. À noter les modalités surréalistes du diagnostic. L’examen clinique n’a pas été le fait d’un ou d’une gynécologue. C’est l’épouse d’un gynécologue barbu, acquis à l’islam intégriste et à l’anonymat de ses clientes, qui s’en charge. Le praticien pose les questions d’usage derrière un drap séparateur et s’en tient aux renseignements fournis pour délivrer ensuite, contre rétribution, des pilules abortives. Le roman aurait pu comprendre un chapitre consacré à l’éventualité d’un garçon.
Le récit aura une heureuse fin.
Daoud admirait la concision du roman-nouvelle de Camus « La chute ». Comme dirait Blaise Pascal, il n’a probablement pas eu le temps de faire court. Il faut plusieurs dizaines d’heures pour apprécier à leur valeur les 400 pages relativement denses de ce dialogue imaginaire.
Dans un échange avec le journaliste Éric Fottorino, Daoud est très critique pour le régime algérien qu’il assimile à une dictature. Il précise que « ce n’est pas une dictature militaire mais que l’on s’y ennuie plus que dans une caserne sans guerre ». Le régime a combattu l’Islamisme avec la dernière énergie, quand son pouvoir était en jeu, allant jusqu’à annuler une élection gagnée par le FIS (Front Islamiste), avant de créer des mosquées en grand nombre. « Il joue, dixit l’auteur, le califat pour calmer ses clients islamistes ». « Il interdit toute opposition, sauf celle qu’il fabrique. » Il relève l’existence d’un « abus d’obéissance », au sein de la population.
L’Algérie, dit-il, « connait une affreuse oisiveté qui pousse ses jeunes à partir, ses femmes à désespérer et ses prédateurs à multiplier les férocités au nom d’Allah ou de la mémoire ». « L’abus d’obéissance » a été vérifié aussi chez nous au temps du Covid. Nous pourrions considérer que la généralisation forcée du numérique induit aussi un abus d’obéissance active. Le clientélisme a toujours été un puissant moteur politique. Et beaucoup de gens s’accordent à dire que nous « allons dans le mur », sans que celui-ci n’ait été encore identifié.
Avec ce roman, Kamel a déclenché, sans surprise, la colère des « décoloniaux ». Nous pouvons admettre qu’avec « Houris » l’idéologie-écran de la culpabilité de la France en prend un coup. Notre pays n’est pour rien dans la guerre civile illustrée par le roman. Il n’est pas possible de faire de la France le bouc émissaire du malheur de la population algérienne, des jeunes et des femmes en particulier.
La « repentance » qui est demandé à notre pays est de la même veine que la « réconciliation » entre algériens. Elle permet d’éviter toute autocritique au régime politique. Pas plus que Kamel Daoud, Boualem Sansal, ou David Duquesne, un français métissé des houillères, nous ne nous sentons concernés par l’imagerie du colon abuseur, identifiable sous des formes diversifiées en Afrique. Il est significatif que ce soit, aujourd’hui, des intellectuels natifs du Maghreb, parfaitement au fait des pratiques et des arrière-pensées des leaders d’opinion algériens, religieux et politiques, qui dénoncent les exactions dissimulées et les stratégies de colonisation à rebours en cours en Europe. La repentance que se plaisent à feindre ou à prescrire nombre de nos dirigeants évoque complaisance, diversion, démagogie et calcul électoraliste.
Notre besoin d’autocritique et de lucidité n’a que faire des postures politiciennes. Le pire des contentieux est celui nourri par le silence complice, lâche ou aveugle. Les rapprochements sincères et amicaux ont besoin de liberté d’examen, d’exactitudes et de franc parler. Le roman de Kamel Daoud s’inscrit dans cette inspiration. On peut estimer, pour notre propre survie, que le temps est venu de mettre un terme à la guerre d’Algérie, qui se poursuit sans dire son nom, et de faire en sorte d’obtenir enfin l’Indépendance de la France. L’expression de la paix pourrait bien être : chacun chez soi, de part et d’autre de la Grande bleue. La France a besoin de pétrole et de gaz et, donc, d’un changement de géopolitique.