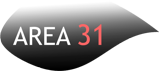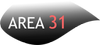31-03-2025
La spiritualité est une des thématiques les plus difficiles à appréhender alors que sa nécessité comme besoin est évidente, pour qui réfléchit tant soit peu. Ce terme est intriqué avec les religions et les philosophies ; ce que nous mettons habituellement derrière ce dernier mot : qu’il s’agisse des courants philosophiques grecs, des cultures asiatiques ou d’ailleurs.
Il est possible de poser la question autrement : un athée ou un « agnostique » peut-il vivre une spiritualité, catégoriquement distincte de la culture religieuse transmise par les générations antérieures ? Cette question n’a rien de théorique pour un pays de culture religieuse.
Aujourd’hui, nombre d’auteurs considèrent la religion comme une survivance. Elle serait un système de contention comportemental, autour de rites plus ou moins contraignants, définissant le bien et le mal, l’interdit et l’autorisé. Les religions gardent une force identitaire au service d’intérêts qui n’ont rien de spirituel. Elles fonctionnent – encore de nos jours – comme un droit de tuer son prochain au nom de la Vérité, consignée dans des textes vieux de nombreux siècles. Elles justifient en pratique le pouvoir de castes, plus ou moins sclérosées et parasites.
Nous pouvons distinguer sans peine des rites, des croyances mais qu’en est-il de la spiritualité ? À quoi ce mot renvoie-t-il, précisément ? Quelle est la part de l’individuel et du collectif dans cette source d’énergie, de présence invisible et de plénitude ? Quelles sont les relations de la spiritualité avec le réel, avec nos différents besoins existentiels ? Pour reprendre l’intitulé d’un thème récent : « Comment faire la part des choses ? » Peut-on vivre sa vie en faisant l’économie de ce besoin latent ?
Comme l’exprime cet ensemble de questions, il est difficile d’avoir une opinion claire, intelligible et, cependant, respectueuse. Socrate nous aide en nous permettant d’affirmer que « nous savons que nous ne savons rien ». De ce point de vue, nous pourrions dire que l’athéisme est une croyance nihiliste en forme de certitude. Socrate est plutôt un agnostique.
La position de l’agnostique est de maintenir l’incertitude au bénéfice du doute. L’avantage de la position d’agnostique est qu’il reste en situation d’ouverture.
Il ne s’interdit ni les sources de connaissance à caractère scientifique ni les sources de connaissance autres, issues de la mythologie, des contes et légendes et, bien évidemment, des religions. Il admet l’existence de besoins irrationnels.
Pouvons-nous nous risquer à une hypothèse ? L’être humain à la différence probable des autres espèces vivantes a la désagréable conscience de sa finitude. Il prend conscience – plus ou moins rapidement – qu’il n’est qu’une poussière face à l’immensité du ciel étoilé. Notre culture se charge de le lui rappeler : « Tu es poussière et tu redeviendras poussière ». Ce qui peut avoir pour effet d’inciter à la jouissance, tant qu’il est temps, par tous les moyens. Comment concilier cette intuition de l’éphémère et du partiel aux besoins de complétude et de durée ?
L’humain expérimente le manque lorsqu’il se sépare de la mère nourricière et de la sécurité qu’elle apporte. Très tôt, il a manifesté des capacités de symbolisation : des rêves de gibier sur les parois des grottes, plus tard, la mémoire des disparus par les monuments funéraires ou d’autres rituels familiaux. Les édifices religieux ont ce paradoxe de célébrer la force de l’esprit par la beauté et l’intériorité qu’ils autorisent. L’Homme a pu ainsi exprimer ce qu’il avait de meilleur en lui et qui, cependant, lui échappait.
Nous savons, par ailleurs, que les croyances débordent le champ religieux. De nombreuses croyances, par exemple, sont entretenues par notre société de consommation. Elles participent à la force de vente et conditionnent nos choix de vie. Dans « Ce que nous apprennent les addictions », j’ai défendu l’idée de choisir une croyance comme support d’émotion et d’identité de rattachement. Ainsi je suis devenu supporteur du Stade Toulousain. J’ai eu de la chance car il s’agit d’un grand club qui donne de belles satisfactions, tempérées d’inquiétude, à ses supporters. Ainsi nous pouvons avoir la sensation de vivre une vie qui n’est pas la nôtre. Un type de croyance en forme d’attachement ne peut se confondre avec une quelconque vérité. Les supporteurs des différentes équipes ont du moins dans ce sport l’intelligence de ne pas se détester.
Pour conclure cette introduction, nous pouvons dire que les croyances, les religions et les spiritualités ont leurs places et leurs fonctions dans les sociétés. Un critère discriminant permet de les distinguer. Un arbre se juge d’abord à ses fruits plutôt qu’à ses racines.
Cela étant dit et très sérieusement, qu’est-ce que la spiritualité ? A quoi renvoie-elle précisément pour vous ?