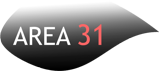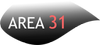Lundi 1er décembre
Le sentiment d’incomplétude est souvent éprouvé par les humains.
Comment le définir ? À quoi correspond-t-il ?
Il peut se définir comme un manque, un vide, un « trou » ? Il évoque la perception douloureuse d’une absence, la tristesse de la « perte d’objet ».
En alcoologie, on peut considérer que l’attirance persistante et irrationnelle pour la bouteille correspond, au-delà de la dépendance biologique ou psycho-comportementale, à une sorte de tour de passe-passe, digne du leurre représentée par l’objet transitionnel, le « doudou » : le manque original étant remplacé par le besoin de se remplir, d’effacer cette perception douloureuse et anxiogène.
Il est facile d’y voir un effet de la séparation de l’univers utérin primitif, d’autant que le nouveau-né est physiologiquement un prématuré, obligatoirement dépendant de soins extérieurs (néoténie : terme savant).
Quoiqu’il en soit, ce besoin de complétude qui évolue ensuite en sentiment d’incomplétude va prolonger notre force vitale en recherchant une altérité qui va prendre des formes très différentes, des plus concrètes aux plus abstraites, des plus sensorielles aux plus affectives. L’absence fait problème.
On peut considérer que la boulimie, la difficulté de vivre seul, le besoin d’altérité et d’amour, la dimension religieuse des humains ont pour origine le besoin de complétude.
Le poète dit : « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ». C’est une raison de s’ouvrir sans cesse à l’altérité mais aussi de se remplir de références symboliques, d’images, de souvenirs et de projets. Le sentiment d’incomplétude peut nourrir une dynamique de vie, un devenir. C’est précisément ce devenir qui devient problème dans nos sociétés.
Ressentez-vous ce sentiment d’incomplétude ? Dans quelles circonstances ? Comment l’atténuez-vous ?