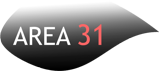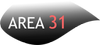22-12-2025
Texte (en brouillon) pour le Tract (Gallimard) en cours d’écriture. Je vous propose, en écho, de dire quelles ressources vous mobilisez pour être à bonne distance de l’addiction.
18-12-25
- La vulnérabilité addictive
Il faut admettre, dans ce domaine aussi, l’inégalité des chances. Nous disposons tous d’un système de récompense, avec des circuits neuronaux enfouis, articulés sur des concentrations de cellules – les noyaux gris – des zones connectées qui, par stimulations diverses, vont produire des neurohormones à l’origine de plaisirs. Les sensations fortes sont la raison d’être des moments dits festifs : dans un champ de paysan, un entrepôt désaffecté ou une maison cossue, désertée par des parents bienveillants. Nul besoin d’avoir une électrode plantée dans une zone appropriée du cerveau pour bénéficier d’une sécrétion de dopamine, de noradrénaline ou d’endorphines. Tout le monde, cependant, n’a pas la chance de tolérer l’alcool : les populations asiatiques ne supportent pas le vin. Pire, il existe des gens, jeunes ou moins jeunes, qui n’ont aucune appétence pour les substances qui pourraient modifier leur conscience. Ils n’éprouvent pas davantage d’attirance pour les jeux d’argent. Leur goût pour le sport ne s’inscrit pas dans la démesure ou l’exceptionnel. En dépit de la publicité, du malaise sociétal et des informations alarmantes, des difficultés économiques, des crises et malheurs familiaux, des doutes et souffrances existentielles, l'alcool ne leur dit rien, sans effort ni qualités particulières. Et pas davantage, les autres variétés d’offre addictogène, ce qui est proprement scandaleux. Un vrai défi pour le commerce et la diversité des institutions et des individus qui ont besoin que les autres s’addictent pour prospérer.
Quelles failles, quelles fragilités peuvent expliquer la vulnérabilité addictive, le basculement dans les addictions ?
Il n’y a pas de gène, ou d’allèle, de déficit enzymatique ou quoi que ce soit d’identifié qui pourraient tenter des partisans de l’eugénisme.
Comme facteurs de risque aléatoires, admis et retrouvés, dans le désordre : la dépression, les anxiétés et angoisses habituelles, les troubles de l’humeur, du caractère et du sommeil ; les abus sexuels sur enfant et adolescent, la rencontre fortuite puis enfouie avec un pervers, la dénégation et l’évitement des parents quand l’enfant donne l’alerte, une attirance irrépressible pour l’interdit, les défauts de soin précoces nourrissant le sentiment d’abandon, les ambiances traumatiques dures – avec violences physiques et verbales – ou molle, – avec les non-dits, la froideur affective, l’absence d’amour ou de tendresse exprimée, mais également le défaut d’autorité expliquée… un liste non exhaustive qui suscite une phrase interminable, à la Pierre Bourdieu.
Les structurations mentales sont des résultantes déterminées par des ambiances émotionnelles, relationnelles et éducatives précoces. Les transmissions inconscientes peuvent sauter une génération alors que l’effet mimétique est indiscutable : on s’addicte comme on apprend à parler. Sans surprise, les organisations limites de la personnalité, l’instabilité et l’excessivité émotionnelle, les troubles bipolaires, la grande anxiété, la dépression au long cours, les pathologies du narcissisme, les structurations psychotiques fournissent l’essentiel de la masse des addictés. Il n’y a cependant pas de relations de cause à effet. Il y a les poids et les contre-poids, les failles mais également les ressources. Ces personnalités sont plus compatibles que d’autres, voilà tout. Plus les perturbations sont fortes et permanentes, plus elles justifient le terme de « comorbidité » et plus le soin s’en trouve compliqué.
Cet inventaire – tout comme les innombrables classifications qui se sont appliquées à distinguer des catégories d’addictés – trouve rapidement ses limites. Les prescriptions de molécules ont leur utilité mais elles ne règlent rien sur le fond. Une image nous a toujours parlé, le nouveau-né est comme un train au sortir d’une grande gare : il y des rails, des aiguillages et des changements de voies successifs et, à un moment, la direction se stabilise. D’autres gares permettront, peut-être, des changements d’aiguillage. Autrement, la voie de l’addiction conduit à un mur. Nous pouvons réfléchir à ce qui peut faire aiguillage.
Des défenses inappropriées
La plupart des personnes souffrant d’addictions mettent en jeu des défenses qui trouveront leurs limites : le déni et le clivage, les silences de la honte et de la culpabilité, une sensibilité aux conformismes, l’anticonformisme étant certainement le pire d’entre eux puisqu’il véhicule l’illusion du pas de côté. L’addiction offre un champ d’observation privilégié pour caractériser et prendre conscience de la force du déni. Il est déconcertant, au premier abord, d’entendre quelqu’un disposant de capacités cognitives et réflexives indiscutables affirmer, en dépit de preuves contraires parfois caricaturales, qu’il boit comme tout le monde, qu’il peut s’arrêter quand il veut ou que, désormais, il fera en sorte de boire modérément.
Au commencement donc de la pratique, les choses étaient claires : les alcooliques étaient les maîtres du déni et, à la rigueur, de sa forme dégradée, la dénégation, qui consiste à reconnaître le problème en partie, de façon à ne prendre aucune décision appropriée : « Je ne bois pas tant que ça, moins que d’autres et je peux contrôler dans une réunion de famille. » Ils pouvaient également se révéler d’opiniâtres menteurs. Rien d’exceptionnel, par conséquent.
L’observation a fini par me convaincre que le déni se retrouvait avec la même force chez la plupart des gens, quand les réalités contrariaient leur subjectivité. Leurs convictions avaient besoin du déni pour survivre et de la dénégation pour faire coïncider leurs croyances aux réalités. Les alcooliques avancent la honte pour justifier les distorsions qu’ils imposent au réel. Nous pouvons leur reconnaître cette caractéristique dont sont dépourvus ceux qui manient le déni et l’amnésie sans faiblir, célébrant aujourd’hui ce qu’ils ont condamné hier.
La relation clinique nous apprend rapidement à contourner l’obstacle paradoxal de l’évidence. Comme souvent, l’essentiel se situe dans ce qui ne se voit pas et ne se dit pas explicitement. Le soignant peut contourner la honte en donnant des exemples, en se satisfaisant du demi-mot. L’essentiel est de considérer la personne, de lui faire raconter son histoire, de rester interactif. Plus avant, il convient de l’aider à prendre conscience de ses capacités d’expression, en paroles et en actes, afin de rendre inutile le recours au déni. Il existe cependant, de temps à autre, les dénis irréductibles. C’est le syndrome du chat du rabbin (*) : devant la cage vide et fenêtre ouverte du perroquet, plumes sur le museau, il s’écrie, face au rabbin : « C’est pas moi ! ».
Les échanges en groupe de parole, sous réserve d’une orchestration adéquate par un soignant rompu à l’exercice, sont étonnants de pertinence et d’authenticité. Les rares cas où le déni reste irréductible renvoient souvent à un entourage accusateur et policier ou à des lésions neurologiques. La défense est permanente, comme une cuirasse rouillée dont il est impossible de se défaire. Le déni est une défense particulièrement inappropriée chez un alcoolique dans la mesure où elle lui interdit de se libérer de l’addiction par une parole vraie. S’il y parvient, en un retournement significatif, il peut alors abandonner le déni aux autres, à ceux qui ignorent la honte.
La difficulté à instaurer une relation de qualité interroge aussi les contre-attitudes et les propres défenses du soignant. Il n’est pas rare que celui-ci fasse usage de sa position d’autorité, entravé par ses propres défenses ou perturbé par ce que le patient peut avoir de dérangeant.
Quelle n’a pas la surprise du soignant quand ayant éprouvé la force du déni au contact des patients les plus réfractaires et ayant appris à les apprivoiser, il découvre la diversité, la banalité et la force du déni chez des personnes exemptes de toute addiction caractérisée. Il commence alors à vivre un décalage croissant au contact des armés-de-certitudes. Il cesse de croire à la spécificité du déni. Il admet l’universalité du déni, défense efficace pour contourner une insupportable lucidité.
Le déni n’est pas seul en cause parmi les défenses mettant le soin en échec. Le clivage de la personnalité est une autre défense qui met à l’épreuve le soignant. Un de nos auteurs préférés, le paradoxal Pierre Bayard (*), argumente qu’en fait plusieurs personnes habitent le même corps. Il prend appui sur quelques exemples célèbres et caricaturaux que l’on retrouve chez des personnalités que nous pourrions qualifier d’hystériques ou de psychotiques. Nous n’engagerons cependant pas une querelle d’école ou de convictions, les réalités cliniques étant assez compliquées en elles-mêmes.
Le clivage nous semble aussi largement partagé et utile que le déni. La psychothérapie a pour ambition de transformer un clivage devenu ingérable et dangereux en ambivalence, avec une capacité à penser le pour et le contre avant d’aller plus loin. Persister dans une conduite préjudiciable invite à prendre en compte « une pulsion de mort » manifeste – pour reprendre une expression de Freud – en essayant de comprendre les raisons d’une autodestruction objective.
Quelle posture adopter face à l’ignorance ? L’ignorance est une défense communément partagée et encouragée. Il est curieux de rencontrer la réticence à apprendre de la plupart des interlocuteurs, ne serait-ce qu’en écoutant, comme le recommandait Plutarque. Comment se soigner sa pathologie sans la connaître et sans identifier les ressources à faire jouer pour en sortir ? A quoi bon, comme soignants, avoir rédigé des ouvrages ou élaboré des vidéos pédagogiques si l’interlocuteur garde une attitude de consommateur passif ?
Nous nous efforçons de faire dire le vécu aux consultants qui le tiraient s’ils estimaient être jugés. Leurs propos, appuyés sur ce qu’ils vivent et ce qu’ils taisaient, sont alors éloquents. Ils éclairent d’une lumière nouvelle, crue et parfois cruelle, des réalités ignorées. Ils apportent indirectement, par leurs expériences de vie, la preuve que les manquements, les absurdités, les gaspillages, les difficultés se retrouvent partout, masquées par des protocoles, des grilles de lecture inappropriées et le principe de précaution.
Un soin profondément inadapté
L’ignorance prend souvent la forme de savoirs spécialisés. De nos jours, les futurs acteurs sociaux, notamment dans le domaine médical, sont soumis à une orientation qui les poussent à se spécialiser sans cesse et toujours plus, en se conformant à des normes, qu’ils ne tarderont pas à reproduire à leur tour. Ils acquièrent ainsi des aptitudes remarquables à la répétition. Leurs connaissances créent des biais. Le risque inhérent à leur spécialisation est de méconnaître des faits émanant de réalités qu’ils ne peuvent appréhender faute de culture et de façon d’être appropriées. Ils s’habituent rapidement à écarter ce qui les dérangent et ils y réussissent très bien. Ils parviennent sans peine à constituer autour d’eux un univers qui confortent leurs convictions et écartent les doutes qui pourraient les habiter, s’ils n’exerçaient pas leur intelligence dans le champ balisé de leur tranquillité.
Sous réserve de ne pas être rétifs à la pensée analogique, il est aisé d’identifier des phénomènes communs à des problématiques distinctes en évitant généralisations et amalgames. Une réalité aussi complexe et composite qu’est l’humain demande un effort de compréhension mobilisant les ressources des différents savoirs.
Un soignant ne cesse d’apprendre au contact des patients, d’autant que leur diversité psychique est sociologiquement évolutive. Les structurations névrotiques deviennent minoritaires, dans le contexte de notre Modernité tardive. Les progrès du tout-numérique et du scrolling compulsif, de l’omniprésence de la communication en images coïncident avec la montée des « organisations limites », des « hauts potentiels » en déficit d’attention, des autistes sur ou sous doués, mais aussi des personnalités narcissiques, perverses, paranoïaques, sans négliger le contingent croissant de psychotiques, de tout âge, des « hikikomori » qui se font livrer au domicile, aux « Diogène » qui l’encombrent d’objets hétéroclites. Le groupe de parole ne fait pas d’exclusive. Celles et ceux capables d’élaboration mentale et de constance sont les bienvenus.
Le soignant, en tant qu’humain ordinaire est en devoir de mobiliser et d’intégrer les différentes sources de connaissance, les différentes grilles de lecture du réel tout en les confrontant à ce qu’en dit le réel. La poésie et, plus largement, nombre de genres littéraires éclairent le réel. Il en est de même des croyances, des mythologies ou des livres religieux. Ceux-ci expriment des vérités transgénérationnelles qui ont valeur d’opinions mais non de lois opposables. Concrètement, un arbre doit être jugé à ses fruits.
Une erreur commune est d’élargir abusivement le champ des interprétations à partir d’une grille de lecture unique, inappropriée par la vision limitée qu’elle autorise. La problématique alcoolique et addictives convoque des grilles de lecture qui se complètent dans la mesure où elles éclairent des champs différents. C’est une vraie pitié de voir se réduire les diagnostics à des étiquettes classificatoires et l’offre de soin à des séjours institutionnels de plusieurs semaines.
Il n’est pas aisé de diminuer son ignorance quand ce qui est connu du Monde – ou du problème posé – est le fait de la Communication. Le contact avec l’altérité est devenu curieusement difficile, même quand il s’agit de son voisin de palier. Longtemps, nous avons pu adhérer, en toute tranquillité, à une version des faits parce qu’elle était unique. Nous avons commencé à douter quand nous avons été confrontés à d’autres versions des faits. Un autre récit prenait forme pour discréditer et remplacer le précédent. Plus le temps passe et plus les témoins autorisés se raréfient. La honte ou l’opprobre peuvent les faire taire, à l’image des rescapés des camps d’extermination, honteux d’avoir survécus.
Le propre de la connaissance est de reposer sur l’observation et la preuve, le temps se changeant de modifier l’observation dans le sens du relatif et du doute, ce qui est une façon de laisser place aux possibles. Faute d’être en situation de vérifier le bien fondé d’une information, il convient d’être assuré de la fiabilité des sources. Nous savons, aujourd’hui, combien ces dernières peuvent être partisanes, orientées, incomplètes, superficielles ou inutilement précises par l’effet de chiffres invérifiables. En pratique clinique, la connaissance s’obtient au fil des années par l’observation de réalités contradictoires ou complémentaires. Plus la connaissance s’affine, tout en restant évolutive, plus elle s’éloigne de la doxa, d’une vérité opposable.
Reste à aborder le silence comme variante informulée du déni. Il s’oppose au silence de l’écoute. Le silence de ceux qui se taisent s’ajoute au silence imposé à ceux qui auraient des raisons de parler. Une forme d’empêchement est celle des bavardages incessants sur des sujets systématiquement rabâchés : actualité du jour, anecdotes, considérations hypochondriaques, médisances, jugements, contre-vérités. Une tablée de journalistes côte à côte, des sous-titres martelant l’info du jour, une séquence de quelques secondes d’images vidéo en boucle. Ces habitudes de censure orale sont complétées, quotidiennement, par la masse des messages numérisés inutiles. Elles viennent en renfort de la censure proprement dite qui relève de l’empêchement ou de l’interdiction de faire connaître son opinion.
Rosa Luxembourg nous a appris que l’illusion de liberté était déterminée par notre immobilisme c’est-à-dire notre conformisme : à condition de ne pas bouger ou de bouger à la vitesse recommandée, dans le sens prescrit, nous ne sentons pas la force de nos chaînes. Dans la longue histoire de notre organisation associative, nous avons interpellé, avec la quasi-régularité d’une pendule, avec la politesse et les formes requises, les Pouvoirs publics pour les convaincre du caractère efficient de notre méthodologie. Nous savons, désormais, qu’une réponse licite et légale de l’Administration est la non-réponse, qui ressemble évidemment au mépris.
Les progrès que notre méthodologie, expliquée jusqu’à plus soif, permet n’ont rien d’incompréhensible ou de surnaturel. Un enfant moyennement doué mais dépourvu de préjugés pourrait les comprendre. La méthodologie résulte d’un effet de transmission par des alcooliques revenus du néant de leur addiction. Il a suffi de les écouter, en confiance, puis de réfléchir pour mettre en forme ce qui semblait utile et nécessaire. Les besoins requis et les résultats obtenus avaient l’inconvénient de ne pas rapporter d’argent aux détenteurs de pouvoirs. Nous avons besoin comme soignants d’ouverture d’esprit, d’écoute, d’humilité, de patience, d’abnégation, mais également d’esprit critique et de créativité pour donner la possibilité à des perdants et à des irresponsables désignés la capacité de prendre leur existence en mains et d’éprouver du plaisir à vivre. Nous avons également un besoin incontournable de personnes devenues sobres, les « aidants », comme sources de repères, de clarifications et d’espoir. L’essentiel ne se situe pas dans le sevrage mais dans la relation d’aide établie. Celle-ci permet de penser l’après immédiat pour donner un présent et un avenir. Le nouveau venu peut faire le pari des solidarités des mêmes (idem) pour devenir lui-même (ipse) (*). À ces conditions, l’alcoolisme – le phénomène addictif – devient une source fraternelle de rencontre, de soi-même, des autres, d’élan et de joie de vivre, toutes caractéristiques peu valorisées au temps de Homo Addictus.
Avoir le courage de lever les dénis qui font barrière au réel, ouvre au dépassement des problèmes qui les suscitent.