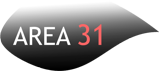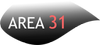10-03-2025
Le syndrome Eichmann est une expression de votre serviteur. Il est peu vraisemblable qu’il ait le même avenir que le syndrome de Stockholm, mais il n’est pas interdit de rêver. C’est à Hannah Arendt que revient le mérite d’avoir fait d’Adolf Eichmann une illustration de la banalité du mal, à la grande indignation des juifs de Palestine décidés à faire de ce sinistre personnage l’emblème d’une monstruosité hors du commun. Si Eichmann était objectivement un tueur en série, dans le cadre du génocide juif, il était, d’un point de vue psychologique proche de nombre d’entre nous. Telle est la thèse d’Arendt.
Si nous acceptons de mettre à part l’historicité de cet officier SS, quelles caractéristiques correspondent à son comportement ?
Notons pour commencer qu’il avait charge de famille, avec femme et enfants. À la différence d’Heydrich, il n’avait pas de mœurs dissolues ni de perversion identifiée.
Il portait l’uniforme militaire de son pays, plus exactement de la force militaire et politique qui garantissait la domination d’Hitler et de ses amis sur la nation allemande. Comme des centaines de milliers d’autres, il était membre d’un parti.
Il était soucieux de promotion personnelle, attentif à mériter les compliments de ses supérieurs hiérarchiques. L’essentiel pour lui, était d’être bien noté et de ne pas faire de vague.
On peut l’imaginer sans peine appliqué à bien faire son travail : remplir les wagons et les faire partir à l’heure, dans la bonne direction.
C’était également un militant qui se voulait contributif. Il ne rechignait pas à proposer des solutions pour débarrasser l’Allemagne de ses juifs. Ainsi avait-il pensé, comme d’autres responsables, les déplacer par bateaux vers Madagascar. C’était loin du territoire allemand mais cet avantage avait un inconvénient c’était coûteux, lent et artisanal.
Il partageait avec les autres responsables du parti la même approche « technique » de la Solution finale. Il était sans haine particulière vis-à-vis de ceux sur lesquels il exerçait son pouvoir. Sans haine mais également sans empathie, en technicien.
Il partageait la morale inculquée et ambiante : l’ordre, la propreté, le contrôle de la violence, l’absence d’enrichissement personnel, le respect de la hiérarchie et l’obéissance aux consignes. Il pouvait enrober le tout de la satisfaction du devoir accompli au service du pays.
Il ne jugeait pas indispensable de penser par lui-même. D’autres s’en chargeaient, à leur place. Chacun était à sa place.
À la question comment a-t-il été possible d’accomplir ces atrocités ? Par l’évitement d’une vue d’ensemble, l’égoïsme, le déni, la chosification ou mieux – pour reprendre un mot actuel – la dématérialisation de l’autre, réduit à un numéro dans un lot. Avec un soupçon de cynisme : Arbeit macht frei (Le travail rend libre).
Le syndrome Eichmann ne serait pas possible si l’environnement ne participait pas à la même approche abstraite de l’autre, à la même indifférence radicale, à des aveuglements analogues. La loi du silence favorise la généralisation et la pérennité du syndrome, aussi sûrement qu’une pandémie.
Il est malheureusement facile de relever des cas de syndrome Eichmann, du côté des administrations et des institutions.
Le cas Eichmann est l’illustration individuelle d’un phénomène collectif. Il est le produit naturel d’une technostructure aux pouvoirs désormais, sans limites, par l’effet de la numérisation prescriptive conditionnant la vie relationnelle, dans tous ses aspects.
Notre alcoologie vit à l’opposé de cette logique. C’est ce qui en assure sa valeur d’usage mais également sa fragilité.
Avez-vous rencontré des cas de syndrome Eichmann dans le cours de votre vie et comme personne ayant des problèmes d’addiction ?
Quelles solutions avez-vous trouvées pour ne pas en subir les conséquences, pour les contenir et, même, pour vous en libérer ?
Dit autrement, comment échapper aux tentacules de l’Administration ?